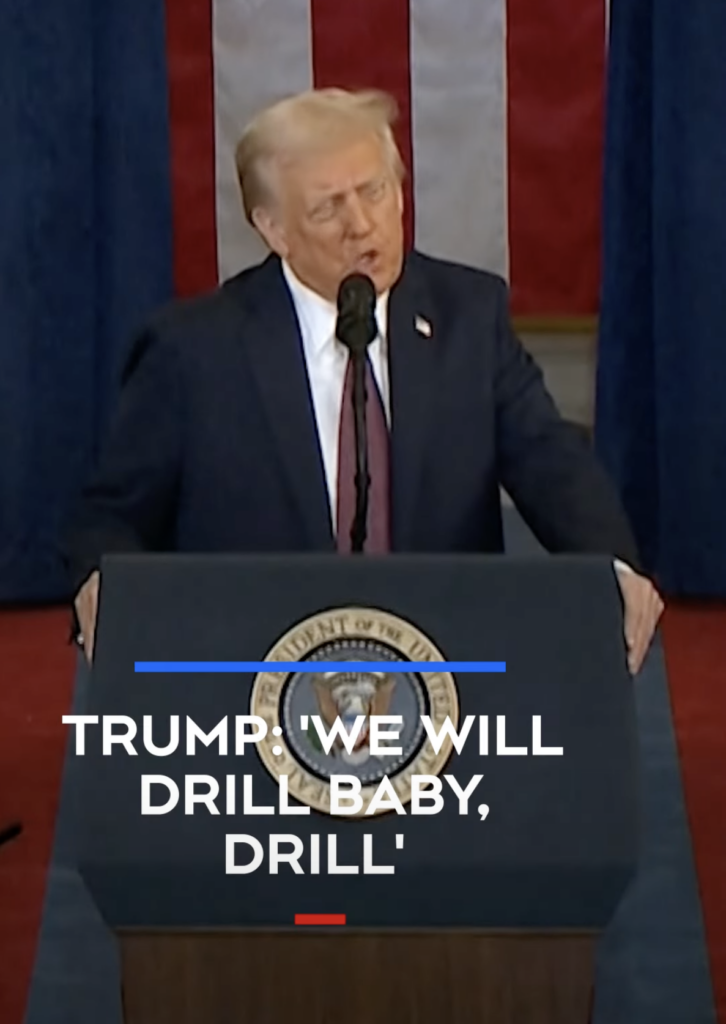
Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche fait craindre à beaucoup (et espérer à certains) une inversion de la tendance mondiale au remplacement progressif des combustibles fossiles au profit des sources d’énergie décarbonées.
Dès son arrivée à la Maison Blanche, le 20 janvier 2025, outre l’injonction à accélérer l’extraction fossile, « drill, baby, drill », Trump a, au travers des Executive Orders « Unleashing America Energy » and « Declaring a National Energy Emergency », aboli des dizaines de réglementations environnementales et mécanismes d’incitation à la transition énergétique. Et l’Executive Order « Unleashing America Energy » a validé une vérité alternative excluant le solaire et l’éolien de la définition des ressources énergétiques nationales.
Il a donc donné l’ordre de rendre plus de terres fédérales disponibles pour l’extraction du pétrole et du gaz, d’annuler le moratoire de Joe Biden sur l’approbation de nouveaux terminaux méthaniers et de suspendre les nouveaux projets éoliens sur les terres et les eaux fédérales. En court-circuitant le Congrès, M. Trump détricotera la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), en particulier le soutien aux véhicules électriques et à l’énergie éolienne en mer.
Rien d’étonnant dans le chef du climatonégationniste qu’est Trump (j’écris bien négationniste et non sceptique), « The global warming hoax, it just never ends. ». Rien d’étonnant non plus dans le chef du très proche des intérêts pétroliers et gaziers qu’est Trump. Rien d’étonnant enfin dans l’inventeur du slogan « Make America Great Again » tourné vers le passé merveilleux où les USA pouvaient s’abreuver de fossiles sans limites.
Entre-temps, les faits nous confrontent, y compris les américains, à de dures vérités. La Terre continue de se réchauffer : 2024 a été la première année où les températures moyennes mondiales ont dépassé de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels et janvier 2025 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. Et si la croissance de la consommation d’énergies fossiles et celle des émissions de gaz à effet de serre a diminué significativement, y compris en Chine, la baisse n’est pas encore observable.
Les craintes de voir Trump stopper la transition énergétique sont compréhensibles. Mais le président républicain n’y parviendra pas, pas plus qu’il ne l’a fait lors de son premier mandat présidentiel. La raison en est simple : les développements technologiques et la baisse des coûts de l’éolien et surtout du solaire photovoltaïque sous l’effet de leur industrialisation massive ont rendu les sources d’énergie renouvelables moins chères que les combustibles fossiles en particulier dans la production d’électricité.
Le développement des nouveaux renouvelables n’en était qu’à ses débuts en 2016 lors de la première élection de Donald Trump. Depuis lors le coût de l’éolien a continué à diminuer (-25% à -30%) et celui du photovoltaïque s’est effondré (-50%). Et le développement des capacités renouvelables a explosé : la production éolienne mondiale a été multipliée par 2,6 de 2016 à 2024 et la production photovoltaïque par . . . 6, la part des nouveaux renouvelables dans la production d’électricité dans le monde passant de moins de 8% à plus de 18%. La révolution verte s’est accélérée et cette dynamique n’est pas due à l’intervention des pouvoirs publics mais aux marchés. Le fait est que le Texas, État pétrolier républicain et très trumpiste, est le leader américain en matière de nouveaux renouvelables qui y représentent en 2024 30% de l’électricité produite (22% pour l’éolien et 7% pour le solaire) contre 13,5% en 2016. Dans le même temps la part du charbon, que Trump voulait augmenter en 2016, est passée au Texas de 27% à 11% de la production d’électricité.
Il sera donc impossible à la politique de bloquer la transition énergétique. Cela ne signifie pas que la politique ne ralentira pas la transition. Les mesures de l’administration Trump pour stimuler la production nationale de pétrole et de gaz, assouplir les réglementations environnementales et climatiques, soutenir les centrales électriques au gaz et réduire les incitations en faveur des énergies propres et des véhicules électriques auront un impact aux USA (335 millions d’habitants). Mais en auront-elles au-delà de leurs frontières (7,6 milliards d’habitants) et surtout en Chine (1,4 milliards) ?
Les décrets de Washington atteindront rapidement leurs limites. Les États-Unis sont déjà un exportateur net d’énergie depuis 2019. Mais comme les prix sont bas, que la production américaine de pétrole et de gaz atteint déjà des niveaux record et que la consommation de pétrole américaine ne cesse de diminuer depuis 20 ans, la production de combustibles fossiles aura du mal à augmenter à court terme, quoi que fasse Trump. Lors du premier mandat de Donald Trump la production de pétrole avait d’ailleurs baissé de 2% (2017 à 2021) malgré l’arsenal de stimulants déployés. Le déploiement des énergies renouvelables aux USA ne s’arrêtera pas, sous l’effet d’une demande croissante d’électricité et d’une baisse des coûts, en particulier pour l’énergie solaire. Quant aux constructeurs automobiles américains ils seront confrontés à un dilemme majeur : continuer à investir dans leurs projets à long terme de véhicules électriques, même sans incitations et financement des infrastructures de recharge, ou renoncer et laisser le champ libre dans le marché mondial aux constructeurs chinois et européens.
L’abandon par les États-Unis de toute ambition de leadership sur les questions climatiques aura d’autres conséquences importantes. Certains pays, comme l’Argentine de Javier Milei, suivront sans doute l’exemple américain. Mais la plupart des pays industrialisés resteront globalement engagés dans l’Accord de Paris : pour l’Europe, la transition est le levier principal pour réduire sa dépendance aux importations de fossiles et améliorer sa sécurité énergétique. L’Inde, qui est aujourd’hui le pays où la croissance des émissions de CO2 est la plus rapide au monde, a choisi la transition comme une opportunité économique et une étape nécessaire pour réduire la pollution de l’air. Enfin, dans la plupart des autres marchés émergents le déploiement des énergies renouvelables s’impose pour de simples raisons de coût.
Mais le plus important se passe en Chine. La Chine domine, début 2025, technologiquement et industriellement la transition dans tous les domaines : solaire photovoltaïque, batteries, véhicules électriques, nucléaire et, même éolien, où l’Europe peut cependant garder des ambitions fortes. Un marché intérieur plus que dynamique soutient des productions de masse qui sont exportables à des prix qui rendent la transition économiquement avantageuse. Nul doute que Xi Jinping se réjouit de l’opportunité que l’administration Trump lui ouvre de gagner encore des parts de marché mondiales, d’accélérer le déploiement des technologies propres et d’engranger de nouvelles baisses de prix. Et donc d’accroître encore son leadership.
La vision passéiste du « Make America Great Again » aura un effet majeur : « Make China Once More Stronger ».
Michel Allé
février 2025